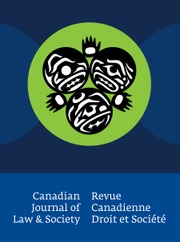I. Introduction
Principe d’organisation politique, la laïcité implique que l’État soit séparé des organisations religieuses et que sa gouvernance s’exerce de façon autonome à l’égard des normativités religieuses. L’État doit être neutre à l’égard des conceptions de la vie bonne présentes dans la société et doit garantir la liberté de conscience et de religion à tou·te·s les citoyen·ne·s, quelles que soient leurs convictions religieuses. Depuis vingt ans, au Québec, la notion de laïcité s’est trouvée au cœur du débat public suite à une crispation des discussions sur les questions de visibilité du religieux dans l’espace public. Dans ce contexte, elle a été bien plus rarement invoquée à propos d’enjeux au cœur desquels elle se trouve également, qu’il s’agisse du financement indirect des lieux de culte, des évolutions du droit de la famille, de la législation sur l’aide médicale à mourir… mais aussi, depuis le début de l’année 2020, de l’organisation par le gouvernement provincial de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
L’objectif du présent article est d’engager la discussion sur la laïcité québécoise à partir des politiques gouvernementales adoptées pour gérer la pandémie de COVID-19. On conviendra que la démarche peut interroger les lecteur·trice·s tant la mise en œuvre du principe de laïcité semble a priori bien éloignée des politiques de santé publique. Elle n’en est pas moins pertinente, les terrains de la laïcité étant en effet plus nombreux et diversifiés que ne le laissent à penser les conditions dans lesquelles elle a été mise en scène et débattue par les gouvernements successifs depuis le milieu des années 2000. Mais les représentations sociales sont fortes et l’emportent aujourd’hui sur une recherche universitaire pourtant féconde dans le champ des études sur la laïcité au Québec. L’adoption de la loi du 16 juin 2019 pompeusement intitulée Loi sur la laïcité de l’État Footnote 1 en est l’illustration alors que l’ambition du législateur n’était nullement d’organiser les relations entre l’État et les religions, mais visait simplement et essentiellement à interdire le port de symboles religieux à certaines catégories de fonctionnaires provinciauxFootnote 2.
1. Laïcité, visibilité du religieux et islam
Désormais, la question de la visibilité du religieux (l’islam essentiellement) structure la façon dont on comprend ce qu’est la laïcité au Québec. Il apparaît d’autant plus important de rectifier cette image réductrice qu’elle trouve largement écho dans les débats médiatiques, politiques, et même dans l’arène juridique. Or la popularité de cette figure de la laïcité, conjuguée à la montée des populismes, peut conduire à des dérives attentatoires aux droits et libertésFootnote 3 et dommageables pour le tissu social. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent article. Bien que sa portée soit limitée à l’analyse de l’un des cas d’application de la laïcité québécoise – la lutte du gouvernement provincial contre la COVID-19 –, il participe ainsi d’une démarche de déconstruction d’une représentation désormais dominante de la laïcité.
Longtemps cantonnée aux seuls champs politiques et universitaires, la question de la laïcité de l’État au Québec est rapidement entrée dans le débat social après que la Cour suprême du Canada a rendu la décision Multani Footnote 4 le 2 mars 2006, suscitant une importante controverse à l’échelle provinciale. Dès la mise en place de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles en 2007, les débats sur la laïcité se sont centrés sur l’expression des convictions de groupes religieux minoritaires, et tout particulièrement des musulmanes dont les vêtements ont accaparé l’espace médiatique et politique. Tranchant avec le déclin d’édifices et de symboles religieux associés à la majorité, comme la réaffectation ou la destruction des lieux de cultes chrétiens délaissés par les fidèles, la nouvelle visibilité de l’islam a rapidement conforté, dans certains segments de la population, un sentiment d’effacement progressif de l’identité culturelle et religieuse majoritaire.
Depuis 20 ans, la centralité de l’islam et de la question du port de symboles religieux dans le débat public a ainsi participé d’une reconstruction idéologique de la laïcité québécoise que l’on retrouve au cœur des discussions sur tous les textes législatifs qui ont été présentésFootnote 5, et parfois adoptésFootnote 6, par les gouvernements successifs à ce sujet depuis 2011. Une norme générale de laïcité (ou d’invisibilité) a ainsi été façonnée à la lumière d’un seul de ses cas d’application, soit les conditions d’expression des convictions religieuses associées à l’islam, éclipsant la pluralité des aménagements juridiques de la laïcité.
2. La COVID-19, impensée et révélatrice de la laïcité au Québec
La focale à travers laquelle la laïcité québécoise a été reconstruite par le politique et médiatisée dans le débat public ne favorise pas la prise en compte de nombreux moments législatifs ou judiciaires qui contribuent pourtant à mettre à distance la norme religieuse dans la régulation juridique et politique de la vie en société et, par là même, la laïcisation du Québec. C’est notamment le cas de plusieurs décisions de tribunaux, comme celles relatives à l’ouverture du mariage aux conjoint·e·s de même sexeFootnote 7, et de lois sociétales, à l’instar de celle ouvrant le droit à l’aide médicale à mourirFootnote 8.
Cette focale sur la visibilité du religieux ne favorise pas non plus la prise en compte des multiples aménagements du droit par lesquels l’État prend en charge certains enjeux sociétaux et régule ainsi, directement ou indirectement, la diversité religieuse. C’est le cas des textes qui ont visé à protéger la santé de la population en contexte de pandémie. Au Québec, plusieurs d’entre eux ont en effet largement affecté les confessions religieuses et les personnes croyantes, règlementant les modalités d’expression collective du religieux et, dans une moindre mesure, d’expression individuelle des croyancesFootnote 9.
C’est ainsi qu’au moment même où la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État était contestée devant la Cour supérieure du Québec, se jouait également un autre enjeu de laïcité. Celui-ci – soit l’impact des mesures d’urgence prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sur certaines expressions du religieux – n’a toutefois pas été abordé comme tel. Il est resté un impensé de la laïcité, révélateur par là même de la réduction de celle-ci aux seules questions relatives à la visibilité du religieux.
Le présent article se penche sur cet impensé. Pour ce faire, il procède d’abord à un rapide rappel des fondements historico-juridiques de la laïcité québécoise en insistant sur l’émergence, dans la gouvernance politique et juridique, de deux principes qui en sont au cœur : la liberté de conscience et de religion, et la séparation des Églises et de l’État, ou l’autonomisation de l’État à l’égard du religieux. Le texte analyse ensuite les effets du dispositif juridiqueFootnote 10 mis en place par le gouvernement québécois pour lutter contre la COVID-19 sur les deux principes susmentionnés. Au regard des principaux apports de la sociologie de la laïcité, ceux-ci peuvent en effet être considérés comme des indicateurs dont la présence et le poids dans le dispositif juridique permettent à l’observateur de retracer l’évolution des postures (idéal-typiques) de laïcité dans la gouvernance politique et juridique de l’État.Footnote 11 À cet égard, l’analyse s’inscrit principalement dans une démarche compréhensive empruntant à la sociologie wébérienne, et cela même si elle permet également de poser un regard critique sur les aménagements de la laïcité québécoise au cours de la période à l’étude.
L’échantillon est initialement composé de tous les décrets gouvernementaux et arrêtés du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec adoptés entre le 13 mars 2020, soit le jour de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, et le 12 mars 2022, alors que les principales limitations à la liberté de conscience et de religion sont levées. Une première analyse de contenu a mobilisé les indicateurs évoqués plus haut (liberté de conscience et de religion; séparation; autonomisation), pour identifier dans le corpus les textes ayant eu une portée laïque directe. Ce faisant, les analyses se sont cantonnées aux seuls règlements qui ont visé les lieux de culte, les indicateurs ne permettant pas de repérer systématiquement les mesures plus générales qui pouvaient affecter indirectement leur accès. Une deuxième phase d’analyse a visé à qualifier la portée laïque des textes sélectionnés en y évaluant la force et la faiblesse de chacun des indicateurs présentés plus haut, tout comme leur articulation entre eux. Précisons que l’analyse n’a porté que sur un matériau juridique, et cela même si nous avons eu recours de façon non systématique aux communiqués et conférences de presse gouvernementaux à des fins interprétatives des justifications apportées aux restrictions à la liberté de conscience et de religion. In fine, cette phase a ainsi permis d’identifier les postures de laïcité qui ont implicitement émergé du dispositif juridique de lutte contre la pandémie.
II. La laïcité québécoise où on ne la voit pas
1. La laïcité, un principe consubstantiel aux démocraties libérales
Le principe de laïcité n’a pas besoin d’être consacré explicitement dans un texte législatif ou constitutionnel pour être effectif. Il n’est pas un simple principe théorique, mais, comme cela a été rappelé, un principe d’organisation politique. Par conséquent, pour symbolique qu’elle soit, la seule entrée de la notion dans le lexique juridique ne suffit pas à en garantir la réalité. Pour analyser si et comment un État met en œuvre la laïcité, il s’agit plutôt d’observer l’effectivité dans sa gouvernance de l’ensemble des principes qui en sont aux fondements : liberté de conscience et de religion; séparation des Églises et de l’État; neutralité de l’État à l’égard des diverses conceptions de la vie bonne; égalité morale des citoyen·ne·sFootnote 12.
Au Québec et dans de nombreuses démocraties libérales, des travaux juridiques et sociologiques ont analysé l’émergence et le poids de ces principes dans les politiques de l’État, permettant d’attester de la réalité d’aménagements laïques dans des contextes nationaux où la laïcité n’était pourtant pas formalisée dans une norme juridiqueFootnote 13. Ces travaux se rejoignent sur un constat : le principe de laïcité est consubstantiel aux démocraties libérales. Il n’est pas de démocratie libérale sans laïcité et il n’est pas de laïcité sans démocratie libérale. Autrement dit, les processus démocratiques et de laïcisation sont intrinsèquement liés, tant dans leurs avancées que dans leurs reculs. On retrouve donc les principes aux fondements de la laïcité dans toutes les démocraties libérales, même si leurs trajectoires historiques divergent. Celles-ci ont d’abord dû gagner en autonomie à l’égard d’Églises qui souhaitaient conserver une influence morale et politique sur les choix de société. Cette réappropriation progressive de la souveraineté populaire s’apparente à un transfert de légitimité qui renvoie au principe de séparation des Églises et de l’État ou d’autonomie de l’État à l’égard du religieux. Ce transfert de légitimité s’accompagne d’un renforcement des fondements de l’État de droit garantissant les droits de la personne, incluant les principes de liberté – dont la liberté de conscience et de religion – et d’égalité – notamment morale – de toutes et tous.
Chacun de ces jalons démocratiques a progressivement été posé dans l’histoire constitutionnelle du Canada, contribuant ainsi à la laïcisation du pays. Ce dernier s’est en effet rapidement engagé dans un lent processus de laïcisation dont on peut retracer les premiers linéaments dès la fin du XVIIIe siècle. Sans pour autant mener à l’affirmation selon laquelle le Canada aurait été précocement laïque – et tomber dans le piège de l’anachronisme épistémologique –, une démarche analytique compréhensive de ce parcours de la laïcité permet néanmoins de retracer les « éléments » ayant émaillé sa gouvernance politique et juridiqueFootnote 14.
2. Garantie de la liberté de conscience et de religion
L’enchâssement de la liberté de conscience et de religion dans la Charte canadienne des droits et libertés est l’aboutissement d’un long parcours engagé dès la fin du XVIIIe siècle. La liberté religieuse des Catholiques est en effet reconnue dès l’adoption du Traité de Paris signé le 19 février 1763. Cette liberté a été limitée quelques mois plus tard avec l’adoption de la Proclamation royale, le 7 octobre 1763, qui imposait le serment du Test, lequel excluait les Catholiques des fonctions militaires et publiques en leur imposant d’abjurer leur fidélité au pape, mais cette limitation a été de courte durée, car la Proclamation royale est abolie par l’Acte de Québec de 1774. La liberté religieuse des Catholiques sera réaffirmée dans l’Acte constitutionnel de 1791. Sur le plan législatif, la Chambre d’assemblée du Bas-Canada adopte en 1832 une loi reconnaissant aux personnes de religion juive les mêmes droits qu’aux autres citoyens. Une Loi sur la liberté des cultes Footnote 15 est adoptée en 1851 pour les deux Canadas.
Au milieu du XXe siècle, dans plusieurs décisions relatives à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah, un groupe religieux minoritaire qui faisait l’objet de nombreuses stigmatisations et discriminations émanant d’autorités politiques québécoises, la Cour suprême s’est fondée sur la tradition constitutionnelle du CanadaFootnote 16 pour réaffirmer la liberté de religion, et principalement la liberté d’exprimer ses convictions religieuses, même si celles-ci heurtent les mœurs de la majoritéFootnote 17. Ainsi, dans l’affaire Chaput c. Romain de 1955, le juge Taschereau affirme que :
Toutes les religions sont sur un pied d’égalité, et tous les catholiques comme d’ailleurs tous les protestants, les juifs, ou les autres adhérents des diverses dénominations religieuses, ont la plus entière liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire personnelle, et l’affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu’une majorité puisse imposer ses vues religieuses à une minorité (…)Footnote 18.
La liberté de religion est enfin enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 1975Footnote 19, puis dans la Charte canadienne des droits et libertés en 1982Footnote 20. Son ancrage au plus haut niveau du dispositif constitutionnel canadien a contribué à ce que la Cour suprême « redécouvre » cette liberté, l’amenant à en préciser les contours et la portée dans une importante jurisprudence.
Dans la décision R. c. Big M Drug Mart de 1985, les juges de la Cour suprême du Canada énoncent ainsi que cette liberté recouvre le droit « de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte, ou par leur enseignement et leur propagation »Footnote 21, et cela « sans crainte d’empêchement ou de représailles [et dans] l’absence de coercition ou de contrainte »Footnote 22. La liberté de religion comporte ainsi un aspect « positif », soit le droit de croire ou de ne pas croire, ainsi que celui d’exprimer ses croyances religieuses, et un aspect « négatif », soit l’absence de coercition ou de contrainte injustifiée par l’État ou par la volonté d’autrui. En vertu de cette décision, il est interdit à l’État ou à tout organisme public « d’imposer une “contrainte religieuse” à des justiciables ou des bénéficiaires de services publics »Footnote 23. On retrouve ensuite la double composante subjective – expression individuelle des croyances – et objective – expression collective des croyances, notamment par le biais d’un culte – de la religion dans les propos du juge en chef Dickson dans l’affaire R. c. Edwards Books and Art Ltd de 1986. S’il se réfère aux « pratiques religieuses » et au « culte religieux », il ajoute que la liberté de conscience et de religion doit aussi s’appliquer aux « croyances intimes profondes qui régissent la perception qu’on a de soi, de l’humanité, de la nature et, dans certains cas, d’un être supérieur ou différent. Ces croyances, à leur tour, régissent notre comportement et nos pratiques »Footnote 24.
Dans l’arrêt Amselem Footnote 25, en 2004, la Cour suprême affine la définition de la liberté de conscience et de religion en s’attachant à définir la « croyance religieuse », et donc à préciser comment évaluer la nature religieuse de la croyance qui sera protégée en vertu de la liberté de religionFootnote 26.
Pour définir la liberté́ de religion, il faut d’abord se demander ce que l’on entend par « religion ». Bien qu’il ne soit peut-être pas possible de définir avec précision la notion de religion, une définition générale est utile puisque seules sont protégées par la garantie relative à la liberté́ de religion les croyances, convictions et pratiques tirant leur source d’une religion, par opposition à celles qui, soit possèdent une source séculière ou sociale, soit sont une manifestation de la conscience de l’intéressé. Une religion s’entend typiquement d’un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. En outre, une religion comporte généralement une croyance dans l’existence d’une puissance divine, surhumaine ou dominante. Essentiellement, la religion s’entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l’individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s’épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l’individu de communiquer avec l’être divin ou avec le sujet ou l’objet de cette foi spirituelle.Footnote 27
Pour la Cour, la croyance religieuse est une croyance personnelle ou subjective, elle n’a pas à être reconnue par autrui – qu’il s’agisse d’une autorité ou d’un·e responsable religieu·x·se, d’un·e expert·e ou de fidèles. C’est plutôt la sincérité de la croyance qui sera évaluée par le tribunalFootnote 28, lequel « doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice »Footnote 29. Si cette conception individualiste et subjective de la croyance religieuse a trouvé écho dans plusieurs décisions de la Cour suprêmeFootnote 30, celle-ci a néanmoins veillé à freiner tout risque de dérive d’interprétation extensiveFootnote 31 en mettant la liberté de religion en équilibre avec l’intérêt généralFootnote 32 ou avec les autres droits et libertésFootnote 33.
On peut considérer que, dès la décision Big M Drug Mart de 1985, la Cour suprême déduisait de la liberté de conscience et de religion une obligation de neutralité de l’État faisant même de ce principe un « élément constitutif » de cette libertéFootnote 34. C’est donc à partir de l’interprétation des conditions de garantie de la liberté de conscience et de religion par l’État que la Cour faisait émerger, pour celui-ci, une obligation de neutralité. Elle jugeait en effet que l’État ne peut « imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue », afin de s’assurer que les minorités religieuses sont adéquatement protégées contre la menace de la « tyrannie de la majorité »Footnote 35. Cette obligation de neutralité sera ensuite très clairement définie par le juge LeBel, dans son opinion dissidente lors de la décision Congrégation des Témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine du 30 juin 2004Footnote 36.
La liberté de religion protégée par l’al. 2a) de la Charte interdit à l’État de contraindre une personne à adopter une croyance particulière comme à y renoncer ou à pratiquer une religion déterminée. Cette obligation conserve un caractère essentiellement négatif. En règle générale, l’État s’abstient d’agir sur le plan religieux. Il lui appartient tout au plus de mettre en place un cadre social et juridique où les consciences seront respectées et où les membres des diverses confessions pourront s’associer pour exercer la liberté de culte qui exprime un aspect collectif fondamental de la liberté de religion et pour organiser leurs Églises ou leurs communautés. Dans ce contexte, le principe de neutralité devra être pris en compte pour apprécier l’obligation des corps publics, telles les municipalités, d’assister activement les groupes religieux Footnote 37. [nos italiques]
Onze ans plus tardFootnote 38, les juges majoritaires se référeront directement et à plusieurs reprises à l’opinion précitée du juge Lebel pour formaliser, sous la plume du juge Gascon, cette obligation de neutralité de l’État comme corolaire de la liberté de conscience et de religion :
En n’exprimant aucune préférence, l’État s’assure de préserver un espace public neutre et sans discrimination à l’intérieur duquel tous bénéficient également d’une véritable liberté de croire ou ne pas croire, en ce que tous sont également valorisés. Je précise qu’un espace public neutre ne signifie pas l’homogénéisation des acteurs privés qui s’y trouvent. La neutralité est celle des institutions et de l’État, non celle des individus.Footnote 39
Le juge Gascon affirme aussi que « ni la Charte québécoise ni la Charte canadienne n’énoncent explicitement l’obligation de neutralité religieuse de l’État. Cette obligation résulte de l’interprétation évolutive de la liberté de conscience et de religion »Footnote 40.
Cette conception de la neutralité ne fera pas long feu au Québec, le législateur ayant rapidement procédé à un détournement du principe en adoptant la loi du 16 juin 2019 « sur la laïcité de l’État »Footnote 41. Avec cette loi, le principe de neutralité ne découle plus du respect de la liberté de conscience et de religion, mais se trouve à l’inverse précisément convoqué pour en limiter l’expression.
3. Séparation progressive des Églises et de l’État et laïcisation du droit
Le principe de séparation prend plusieurs formes, celles-ci n’étant pas exclusives les unes des autres. Premièrement, il s’agit d’une séparation entre les Églises et l’État, qui peut se traduire par l’absence de religion d’État ou d’association de celui-ci, de jure ou de facto, avec une ou des Églises. Elle s’incarne également dans le non-financement des cultes et la gestion étatique des administrations publiques qui ne doit pas être déléguée à des Églises ou groupes confessionnels. Deuxièmement, il s’agit d’une séparation des normativités religieuses et civiles qui renvoie à la laïcisation du droit, soit au processus par lequel les normes étatiques ne sont plus déterminées ou justifiées, directement ou indirectement, par des considérations religieuses, tout référent religieux en étant progressivement évacué. Par exemple, la dépénalisation de l’avortement, l’aide médicale à mourir ou les réformes du droit de la famille sont autant de mesures traduisant la perte d’emprise des normativités religieuses sur la loi civile, un tel processus s’apparentant à une laïcisation du droit.
Le principe de séparation n’a pas été formellement proclamé avant l’adoption de la loi québécoise « sur la laïcité de l’État ». Il n’en demeure pas moins que cette séparation a émergé très tôt dans la gouvernance politique et juridique, son énonciation formelle dans le droit positif en 2019 ne faisant que confirmer un processus déjà largement engagé. Plusieurs jalons constitutionnels et jurisprudentiels ont en effet contribué à conforter ce principe. On en trouve une première trace dès l’adoption de l’Acte constitutionnel de 1791 qui ne revient pas sur la liberté des cultes déjà garantie, mais limite l’exercice de certains droits civils pour les membres des clergés catholiques et anglicans, amorçant ainsi la séparation entre les fonctions politiques et religieusesFootnote 42. La Loi constitutionnelle de 1867Footnote 43 et la Loi sur l’Amérique du Nord britannique de 1871 seront, pour leur part, quasiment muettes en ce qui concerne la religion, ce qui a parfois été interprété comme une réaffirmation implicite d’une séparation entre l’État et les Églises, lesquelles ne sont pas associées à la gouvernance. Dans ce contexte, et comme l’avaient d’ailleurs rappelé les juges dans la décision Bruker c. Marcovitz du 14 décembre 2007Footnote 44, la Cour suprême s’est toujours fondée sur cette tradition constitutionnelle pour contribuer au processus de laïcisation : elle a renforcé progressivement la liberté de conscience et de religion affirmant, pour ce faire, l’absence de religion d’État au Canada dans des décisions où la liberté de religion d’individus membres de groupes très minoritaires était menacée par l’ÉtatFootnote 45.
Le processus de séparation s’inscrit plus nettement dans la gouvernance politique avec la Révolution tranquille. Outre une laïcisation rapide des institutions sanitaires et sociales, plusieurs mesures sont prises dans le domaine de l’Éducation, notamment avec la création du ministère des Affaires culturelles (1961) et du ministère de l’Éducation (1964), et la mise sur pied du réseau d’enseignement collégial (1968). L’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne en 1975Footnote 46, puis de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, permettront d’accélérer un processus encore inachevé de laïcisation de l’Éducation, la primauté accordée aux droits fondamentaux de la personne dans l’ordonnancement juridique remettant drastiquement en question son organisation confessionnelle.
L’adoption de ces deux textes a également contribué au processus de laïcisation du droit, ce dont témoignent plusieurs décisions de la Cour suprême. À cet égard, la décision Big M Drug Mart précitée, qui a porté sur la constitutionnalité de la Loi sur le dimanche Footnote 47, est une importante décision de « séparation/autonomisation ». En effet, la Cour y conclut que la loi litigieuse poursuit un objectif « religieux »Footnote 48, soit celui de rendre obligatoire l’observance du sabbat chrétien, et porte ainsi atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie à l’al 2 a) de la Charte Canadienne. Or, cette atteinte à la liberté de conscience et de religion procède d’un droit qui n’est pas suffisamment laïcisé, la loi s’inspirant des valeurs religieuses de la majorité pour décider de l’organisation de la vie en société :
Dans la mesure où elle astreint l’ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien, la Loi sur le dimanche crée un climat hostile aux Canadiens non chrétiens et paraît en outre discriminatoire à leur égard. Elle fait appel à des valeurs religieuses enracinées dans la moralité chrétienne et les transforme, grâce au pouvoir de l’état, en droit positif applicable aux croyants comme aux incroyants. Footnote 49 [nos italiques]
Cette autonomisation du droit à l’égard du religieux ressort aussi de plusieurs décisions qui ont contribué à des avancées sociétales significatives, notamment sur certaines questions éthiques ou relatives aux droits sexuels et reproductifs. Tel est le cas de la décision Morgentaler Footnote 50 invalidant l’article 251 du Code criminel (C.cr.) aux termes duquel l’avortement était, outre certaines exceptions, une infraction criminelle pour la femme se faisant avorter et pour le médecin réalisant ce soin. Les propos de la juge Wilson sont révélateurs. Dans des motifs concordants où elle cite la décision Big M Drug Mart, elle affirme que l’article 251 C.cr. contrevient à la liberté de conscience et de religion puisque
la décision d’interrompre ou non une grossesse est essentiellement une décision morale, une question de conscience [(…) Elle ajoute ensuite que] la question qui se pose est donc : quelle conscience? La conscience de la femme doit‑elle prévaloir sur la conscience de l’État? Je crois […] que dans une société libre et démocratique ce doit être la conscience de l’individuFootnote 51.
La primauté accordée à la conscience individuelle sur une « conscience de l’État » protège ainsi les femmes de contraintes morales et religieuses dont les traces peuvent, le cas échéant, perdurer dans la loi.
L’invalidation de l’article 241 b) C.cr. dans la décision Carter Footnote 52 en 2015, qui ouvre la voie à l’aide médicale à mourir, est un autre exemple d’une séparation des normativités religieuses et civiles. Alors que, dans une précédente décision de 1993, la Cour suprême invoquait « la vie » et son caractère « sacré » comme valeur fondamentaleFootnote 53 pour confirmer la constitutionnalité de l’article 241 b), elle lui substitue désormais « l’autonomie et la dignité d’un adulte capable qui cherche dans la mort un remède à des problèmes de santé graves et irrémédiables »Footnote 54, et favorise le choix individuel de la personne concernée.
Ces deux derniers exemples témoignent de l’interférence directe entre la laïcité et certaines questions de santé publique (essentiellement l’avortement et l’euthanasie), ce que les publications universitaires ont d’ailleurs documenté dans plusieurs contextes nationaux, surtout en Europe et en Amérique latineFootnote 55. Au Québec et au Canada, les enjeux de santé publique demeurent cependant un angle mort des débats et travaux sur la laïcité alors même que ces terrains sont propices à la gripperFootnote 56.
III. Ce que la COVID-19 a fait à la laïcité québécoise
1. Restrictions de la liberté de culte : la liberté de religion comme liberté de second rang
Pour lutter contre la COVID-19 et pour des raisons d’état d’urgence sanitaire, le gouvernement provincial a adopté des mesures limitatives des droits et libertés dont le non-respect pouvait être pénalement sanctionné par amendeFootnote 57. Y figuraient la suspension des activités dans les lieux de culte et l’imposition de conditions particulières pour y accéder, ce qui limitait l’expression collective des croyances. Ces limitations peuvent être légitimes en contexte de pandémie. On soulignera cependant à quel point cette liberté d’expression s’est retrouvée dans un angle mort des débats, tantôt absente, tantôt reléguée au second rang, reflétant le peu de cas que le gouvernement du Québec accordait à ce droit fondamental au moment même où il s’attachait à défendre devant les tribunaux des clauses dérogatoires permettant de passer outre aux atteintes à la libre expression individuelle des croyances de plusieurs catégories de fonctionnaires provinciauxFootnote 58.
1. La fermeture des lieux de culte
Le 13 mars 2020 est adopté le Décret 177-2020 Footnote 59 déclarant l’état d’urgence sanitaire et interdisant les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes. Le 15 mars, la ministre de la Santé et des Services sociaux ordonne que certains « lieux qui accueillent le public […] doivent suspendre leurs activités »Footnote 60. Cette mesure concernait principalement le secteur culturel et des loisirs, mais, le 16 mars, le gouvernement précise que les rassemblements doivent également être suspendus dans les lieux de culte « à moins d’être essentiels »Footnote 61. Il se reprend deux jours plus tard en annonçant que les rassemblements sont interdits « dans les lieux de culte, et ce, sans exception »Footnote 62. Cette interdiction est levée le 25 juin, date à partir de laquelle les rassemblements de 50 personnes et moins sont autorisésFootnote 63. Quelques mois plus tard, les rassemblements publics sont régis selon un système de paliers d’alerteFootnote 64. Le Décret 2-2021 Footnote 65, qui entre en vigueur le 9 janvier 2021, interdit de nouveau les activités dans les lieux de culte dans les régions classées en « zone rouge », à l’exception des cérémonies funéraires. Cette interdiction est levée le 21 janvier 2021 alors qu’il est arrêté que les rassemblements de 10 personnes maximum y sont permisFootnote 66. Le 31 décembre 2021, les activités exercées dans les lieux de culte sont de nouveau suspendues, sauf pour les cérémonies funérairesFootnote 67, et cela jusqu’au 7 février 2022Footnote 68. À l’exception des trois périodes évoquées ci-dessus, l’accès aux lieux de culte (et par conséquent l’exercice du culte) n’a pas été interdit, mais a été restreint, notamment par la mise en place d’un système de paliers d’alerte variant au gré des nouveaux cas déclarés de COVID-19. Chaque semaine, le nombre et les conditions dans lesquelles des personnes pouvaient être admissibles dans les édifices cultuels – port du masque, distanciation sociale – faisaient ainsi l’objet de révision. À ces restrictions s’ajoutaient plusieurs mesures imposées en fonction de l’état d’urgence sanitaire qui ont également limité indirectement l’accès aux lieux de culte : les mesures d’isolement obligatoire, les interdictions de sortie pour certains groupes vulnérables et le couvre-feu.
Dès le début de la pandémie, ces restrictions à la liberté de conscience et de religion sont contestées par des dirigeants religieux. Le porte-parole du Conseil musulman de Montréal demande « comment le premier ministre peut-il prendre la décision de fermer une des institutions les plus importantes en temps de crise ? » et ajoute que la suspension des activités dans les lieux de culte « traduit un manque de connaissances sur les responsabilités qu’ont les mosquées dans notre société en temps de crise ». Celui du Conseil des juifs hassidiques du Québec dira qu’il « est très douloureux pour nous de devoir fermer ces endroits [les lieux de culte] (…) Dans notre religion, c’est instinctif de vouloir prier lorsqu’on se trouve dans une situation comme celle que nous vivons depuis quelques jours »Footnote 69. D’autres plaintes s’expriment également par le biais des communiqués d’une nouvelle Table interreligieuse de concertation du Québec (TICQ) créée dans le contexte de la pandémie pour donner écho à la voix de groupes religieux qui regrettent de ne pas être écoutés par le gouvernementFootnote 70. Le Conseil des juifs hassidiques a par ailleurs contesté devant les tribunaux plusieurs mesures, dont le couvre-feuFootnote 71 et la limitation du nombre de personnes pouvant se retrouver dans un lieu de culteFootnote 72 en se fondant sur la liberté de conscience et de religion. Mettant en balance cette liberté avec des objectifs de santé publique, les juges ont validé les mesures litigieuses.
2. L’imposition du passeport vaccinal
Le gouvernement provincial a également instauré un passeport vaccinal par décret. Ainsi, dès le 15 septembre 2021, il fallait être « adéquatement protégé » pour pouvoir accéder à certains lieux publicsFootnote 73, parmi lesquels sont inclus, le 15 novembre 2021Footnote 74, les lieux de culte ou, plus précisément, ceux « dont l’assistance pour l’ensemble du bâtiment où il est situé est de plus de 250 personnes »Footnote 75. Lors de la conférence de presse du 16 décembre 2021, le premier ministre du Québec annonce que le passeport vaccinal sera imposé dans les lieux de culte de manière beaucoup plus restrictive. Alors qu’un journaliste lui demande comment les autorités comptent s’assurer que cette obligation serait respectée dans un contexte où elle entre en porte-à-faux avec la liberté de religion des croyant·e·s, il semble minimiser la portée de cette liberté et tente cette réponse hasardeuse :
I think that these people are responsible people. I’ve meet last year with representatives of different religions, and they asked me if they can have the same rights as a restaurant. They said why can, we cannot have a place… a passports and restaurants can? So, them, they asked for it. So, I think that they are responsible people like the owners of restaurants and I have confidence that they will respect the rules. […] Like with restaurants. When you have to apply some rules, you can expect that someone will come and check if you apply the rules.Footnote 76
Si l’on se fie aux communiqués publiés par la plupart des dirigeants religieux, la question est pourtant plus litigieuse qu’il n’y paraît. La TICQ demande la levée de l’imposition du passeport vaccinal et exprime « un malaise profond face à l’imposition du passeport vaccinal à l’entrée de ces lieux essentiels, dont la mission implique l’accueil inconditionnel »Footnote 77. D’autres voix rejoignent cette demande, dont celle de l’Assemblée des évêques du QuébecFootnote 78. L’imposition de ce passeport sera d’ailleurs spécifiquement contestée devant les tribunauxFootnote 79. Les contraintes à respecter pour l’exigence du passeport vaccinal seront rendues plus restrictives dès le 20 décembre 2021Footnote 80. Celui-ci devient obligatoire dans les lieux de culte sans exception, et ce, jusqu’au 21 février 2022Footnote 81. Cette obligation sera abrogée pour l’ensemble des lieux publics le 12 mars 2022Footnote 82.
2. Congé de dimanche, célébrations des fêtes de Noël : la persistance d’un ethos chrétien dans la gouvernance
Si plusieurs des mesures de lutte contre la pandémie sont révélatrices du poids accordé par le gouvernement provincial à la liberté de conscience et de religion, elles le sont aussi de sa conception du principe de séparation, lequel n’est appréhendé qu’au niveau institutionnel, soit entre l’État ou des administrations publiques et des Églises ou des groupes confessionnels. Deux d’entre elles illustrent la prégnance d’un ethos chrétien dans la gouvernance.
1. Le repos hebdomadaire le dimanche
En mars 2020, le gouvernement québécois ordonne aux commerces non essentiels et lieux qui accueillent le public de cesser leurs activités le dimanche, seuls les commerces essentiels pouvant continuer à opérerFootnote 83. Une semaine plus tard, l’Arrêté 2020-012 prévoit « que tous les établissements commerciaux de vente au détail soient fermés au public le dimanche, à l’exception des pharmacies, des dépanneurs, des stations-service, des restaurants pour les commandes à l’auto, les commandes pour emporter et la livraison, de même que des épiceries pour les commandes en ligne ou par téléphone et la livraison »Footnote 84 [nos italiques]. Cette obligation de fermeture le dimanche qui ne doit initialement durer que le mois d’avril 2021Footnote 85, est finalement prolongée jusqu’au 24 maiFootnote 86. La mesure est ensuite renouvelée le 31 décembre 2021 pour plusieurs dimanches consécutifsFootnote 87. Ce faisant, le gouvernement indique explicitement vouloir garantir une journée de repos hebdomadaire pour tou·te·s les employé·e·s. Alors qu’il annonce cette mesure en mars 2020, le premier ministre affirme : « On veut que les employés prennent du repos. Je pense que ça va être bon pour tout le monde que tous les dimanches d’avril les épiceries seront fermées »Footnote 88. Il tient des propos similaires dans une conférence de presse de décembre 2021, où il justifie le renouvellement de cette disposition : « c’est important de reprendre une mesure qu’on avait mise en place l’année dernière, c’est-à-dire de fermer les commerces le dimanche pour donner une chance aux commerces qui manquent d’employés au moins d’avoir une journée de répit »Footnote 89.
On ne saurait affirmer que l’objectif poursuivi par les arrêtésFootnote 90 du ministre de la Santé et des Services sociaux était directement religieux, ceux-ci faisant preuve d’une stricte neutralité des buts. Par contre, les justifications qui leur sont apportées ne sont peut-être pas aussi neutres qu’elles le paraissent. En effet, si le gouvernement ne se réfère jamais explicitement à un dispositif normatif religieux pour justifier ses arrêtés, ces derniers reposent bien sur un substrat religieux chrétien qui détermine le dimanche comme journée du sabbat hebdomadaire applicable à tout·e·s. Pour neutres qu’ils puissent paraître, ils ne le sont donc qu’« en apparence ». En effet, la patrimonialisation de certains symboles religieux chrétiens et l’ancrage dans la culture de certaines pratiques ou coutumes n’en ôtent pas la charge religieuse intrinsèque. Qui plus est, ils ne sauraient servir de justification – même implicite – à la façon dont on détermine – même en temps de pandémie – certains aspects de la vie en société dans des conditions limitatives des droits et libertés de certaines minorités. Dans sa décision Big M Drug Mart, la Cour suprême du Canada précisait en effet qu’: « une majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue »Footnote 91.
2. Le « contrat moral » de la période des fêtes
À l’approche des fêtes de fin d’année 2020, le gouvernement québécois annonce qu’il entend conclure un « contrat moral » avec les Québécois.esFootnote 92. Celui-ci implique, d’une part, que le gouvernement autorise les rassemblements pour une période de quatre jours ciblée – les 24, 25, 26 et 27 décembre –, d’autre part, qu’un isolement volontaire de 7 jours précède et succède les rassemblements ainsi constitués. La conclusion de ce « contrat » est alors conditionnelle au maintien du nombre de cas diagnostiqués de COVID-19 dans la province entre sa présentation aux Québécois.es et le début du temps des fêtes; en raison de l’augmentation des cas, le contrat n’a pas pu être « conclu » et l’interdiction de rassemblement en vigueur pour la période des fêtes de fin d’année a été maintenue.
Il reste que le contrat proposé par le gouvernement aux Québécois.es est bien « un contrat moral », et non un « contrat social ». En effet, il vise à favoriser les rassemblements familiaux les 24 et 25 décembre, soit pour célébrer la fête de Noël qui, même sécularisée, n’en demeure pas moins une fête religieuse chrétienne. Ce contrat repose donc sur une « morale » ou une conception particulière du bien que tou·te·s les citoyen·ne·s ne partagent pas. Il est donc inégalitaire, excluant plusieurs parties du vivre-ensemble québécois, et liberticide, leur imposant des conditions potentiellement restrictives de leurs droits et libertés. Ainsi, la période d’isolement volontaire nécessaire pour bénéficier d’une liberté de mouvement pendant la période de Noël coïncide avec la fête juive d’Hanoukka, avec, pour effet, de restreindre la liberté d’un groupe minoritaire pour privilégier celle de la majorité. À cet égard, alors qu’il est interrogé sur cette question, les propos du premier ministre sont éloquents :
I think that right now we have a very critical situation. We think that we can permit gatherings during 4 days so where do we put those four days? (…) we think in Quebec that most of the people will be happy with those four (…) days so that’s the way we chose those four days. Footnote 93 [nos italiques]
Un an plus tard, alors que le gouvernement envisage d’autoriser les rassemblements familiaux les 24 et 25 décembre, le premier ministre affirme : « je veux dire aux Québécois qu’on pense qu’on va passer dans les prochaines semaines une très dure épreuve, mais c’est pas la première fois que notre peuple fait face à une grande épreuve et on a toujours réussi à se serrer les coudes pis être capables à avoir une grande cohésion sociale entre nous »Footnote 94. Le sens de ce « nous » transparaît des propos du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé qui, quelques jours plus tard, indique : « Je pense qu’il est tout à fait normal (…) qu’on ait le goût de retrouver Noël (…) Le premier ministre, lui, pense à Noël, pense en Québécois comme tout le monde, moi inclus. On a hâte ».Footnote 95 Il s’agit là d’un type de rhétorique qui contribue à re-ethniciser la nation québécoise dans sa chrétienté, avec des effets d’autant plus excluants sur le plan symbolique pour celles et ceux qui ne peuvent s’y reconnaître.
IV. Conclusion
Dans les débats contemporains, la construction de l’islam comme problème et l’emphase mise sur cette religion ont éclipsé de nombreux enjeux laïques, tant au regard des gouvernant·e·s politiques que de la plupart des observateur·rice·s. Les politiques adoptées par le gouvernement québécois entre 2020 et 2021 pour lutter contre la pandémie en sont l’illustration. Alors que journalistes et universitaires commentent et analysent les auditions tenues dans le cadre de la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État, plusieurs questions relevant des politiques de laïcité tombent dans un angle mort. Elles ont pourtant des impacts directs et significatifs sur les conditions d’exercice de la liberté de conscience et de religion et, plus largement, sur ce qu’est la laïcité au Québec.
Si les politiques menées en temps de pandémie sont bien un impensé des débats et analyses sur la laïcité québécoise, celui-ci est particulièrement évocateur de l’improbable dialectique dans laquelle la laïcité québécoise semble s’être désormais engagée : 1) la délégitimation toujours plus forte de la liberté de religion comme composante essentielle de la laïcité, tout particulièrement quand il s’agit de celle des minorités; 2) la prévalence d’un ethos chrétien dans les aménagements laïques québécois, comme le traduisent les tiraillements de cette laïcité entre ses ancrages historiques, politiques et culturels à haute charge symbolique, et des effets sociaux très concrets et immédiats – dans le cas qui nous concerne, la lutte contre la pandémie de COVID-19.
La laïcité québécoise se révèle donc bien équivoque. Le faible poids accordé à la liberté de religion lui confère d’abord les traits d’une laïcité de type « antireligieuse », où prime une liberté de conscience conditionnée par l’affranchissement préalable à l’égard de la religion et où « la séparation doit tendre à supprimer l’influence sociale de la religion ». Il s’agit donc d’une laïcité ultimement perçue comme « un moyen d’imposer une sécularisation complète (…)Footnote 96. Toutefois, le religieux n’est pas complètement évacué, et il est même mobilisé de façon très opportune par le gouvernement, comme un rappel à certains éléments constitutifs de l’identité nationale. À cet égard, la laïcité québécoise emprunte aussi les traits d’une « laïcité identitaire », souvent valorisée par les partis à la droite de l’échiquier politiqueFootnote 97. Celle-ci impose une forte obligation de neutralité aux individus et limite leur liberté de religion, tout particulièrement quand leurs convictions et pratiques ne sont pas normalisées dans la culture de la société majoritaire. Dans le même temps, elle valorise dans le même mouvement le christianisme en tant que composante de l’identité nationaleFootnote 98.
Au Québec, le gouvernement dirigé par le premier ministre François Legault a été particulièrement proactif dans le débat sur la laïcité, contribuant à la redéfinition des contours de la notion en droit, mais aussi dans les imaginaires collectifs. Cette étude invite cependant à se distancer du prisme à travers lequel ce gouvernement – et d’autres avant lui – tente de déterminer les termes de la discussion – y compris scientifique – sur la laïcité, et à ne pas y restreindre l’analyse. Le risque serait alors celui de l’atrophie d’un objet d’étude (la laïcité québécoise) dont les terrains à défricher sont aussi nombreux que diversifiés.