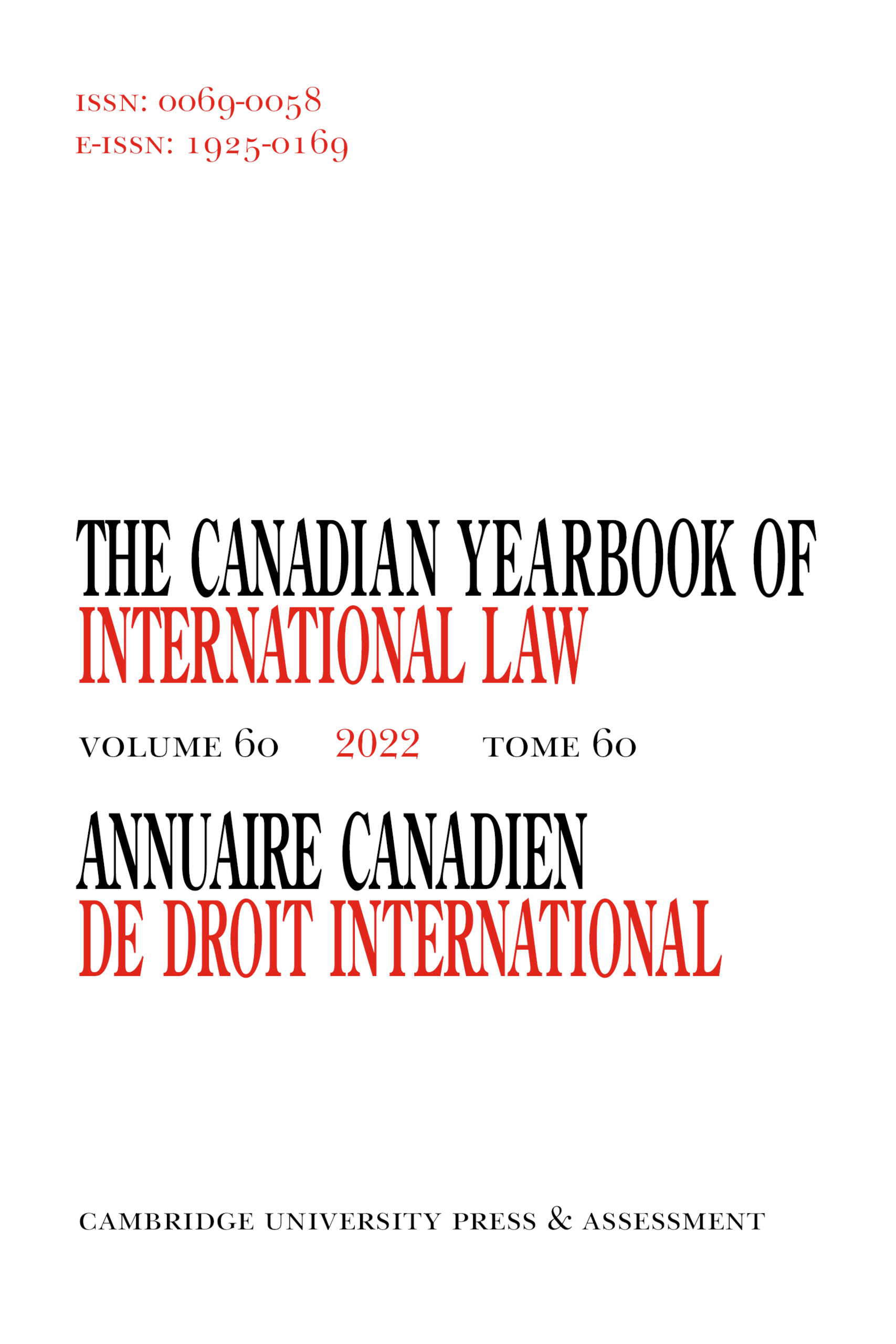1. Introduction
Dès la mise en place de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1947, la nécessité d’un mécanisme de règlement des différends efficace s’est imposée comme un enjeu central du commerce multilatéral.Footnote 1 Le système initial reposait sur le principe du consensus, donnant aux parties contractantes la possibilité de bloquer l’établissement et la composition d’un groupe spécial ou d’empêcher l’adoption des rapports qui leur étaient défavorables.Footnote 2 Ce manque de contrainte affaiblissait considérablement l’effectivité du mécanisme de règlement des différends.Footnote 3 Les grandes puissances commerciales, telles que les États-Unis et les Communautés européennes, utilisaient fréquemment leur influence pour contourner ou ignorer les recommandations des panels, érodant ainsi la crédibilité du système commercial multilatéral et favorisant le recours à des mesures protectionnistes unilatérales.Footnote 4 Cependant, pour le Canada et d’autres puissances moyennes, dont la prospérité économique dépend d’un commerce international stable et prévisible, il était crucial de renforcer un système multilatéral fondé sur la règle de droit. À partir des années 1980, les initiatives du Canada pour un mécanisme de règlement des différends plus contraignant et rapide se sont donc multipliées.
Cet article se propose d’examiner le leadership du Canada dans l’évolution du système de règlement des différends, en mettant en lumière ses contributions essentielles. Nous procèderons à une analyse en trois temps: d’abord son rôle dans les réformes du système sous le GATT jusqu’au cycle d’Uruguay, puis son influence dans l’élaboration et la mise en place de l’Organe de règlement des différends (ORD) lors du passage du GATT à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et enfin, son engagement continu pour préserver l’efficacité du mécanisme et répondre aux crises actuelles que traverse l’OMC.
2. La contribution du Canada au renforcement du mécanisme de règlement des différends sous le GATT
D’après les dispositions initiales des articles XXII et XXIII du GATT de 1947, la résolution des différends reposait sur l’intervention collective des parties contractantes, qui devaient seules arbitrer les conflits surgissant entre certaines d’entre-elles.Footnote 5 C’est pourquoi, après la création du GATT en 1947, les procédures de règlement des différends ont progressivement été consolidées, notamment à travers la décision du 5 avril 1966 sur les procédures d’application de l’article XXIIIFootnote 6 ou le Mémorandum sur les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance du 28 novembre 1979 (Mémorandum de 1979).Footnote 7 Toutefois, les initiatives les plus notables ont émergé après le cycle de Tokyo (1973–79), conduisant à l’introduction de plusieurs changements fondamentaux.
A. Du cycle de Tokyo au lancement du cycle d’Uruguay (1979–86), le Canada face aux limites du mécanisme de règlement des différends sous le GATT
Si le cycle de Tokyo a permis d’établir des bases plus solides pour certaines disciplines commerciales, il n’a pas résolu tous les problèmes systémiques liés aux procédures de règlement des différends. Bien qu’il ait abouti à la signature du Mémorandum de 1979, son objectif se limitait à consolider les pratiques antérieures relatives aux obligations de notification, les procédures de consultations et la rapidité du règlement des différends.Footnote 8 Alors que la pratique générale restait qu’une partie contractante, y compris la partie défenderesse, pouvait bloquer la procédure de règlement des différends (établissement, composition des groupes spéciaux ou adoption des rapports), certains codes de Tokyo apportaient déjà des évolutions considérables en rendant obligatoires les procédures de règlement des différends, comme le code sur l’antidumping en vertu duquel “si une solution mutuellement convenue n’a pu intervenir dans un délai de trois mois […] le comité, à la demande de toute partie au différend, instituera un groupe spécial.”Footnote 9
Pour autant, au lendemain du cycle de Tokyo, les limites du règlement des différends sont devenues de plus en plus évidentes. Il faut dire que l’élargissement considérable du champ matériel du droit de l’OMC a contribué à démultiplier le recours aux procédures de règlement des différends.Footnote 10 Face aux limites des procédures de l’époque, la délégation du Canada, dans une communication d’avril de 1982, soulignait alors les efforts effectués durant les négociations du cycle de Tokyo pour consolider les mécanismes de règlement des différends du GATT, mais que “l’expérience récente donne à penser qu’il est nécessaire d’affiner et d’améliorer encore le système de règlement des différends afin qu’il continue de répondre aux besoins de toutes les parties contractantes.”Footnote 11 Trois mois plus tard, la délégation canadienne est revenue vers les autres parties contractantes avec une proposition visant à examiner cinq questions prioritaires: le dépôt en temps voulu des constatations des groupes spéciaux, la composition et le rôle de ces groupes spéciaux, le rôle du secrétariat, et l’adoption et la mise en œuvre des rapports.Footnote 12 Le Canada a notamment proposé une réévaluation de la compétence des membres des groupes spéciaux pour inclure davantage d’experts des capitales, et l’autre approche suggérée par Ottawa consistait à remplacer les groupes spéciaux ad hoc par un groupe permanent d’experts attaché au Secrétariat. Cette proposition visait à garantir que les rapports soient bien documentés, fassent autorité et soient adoptés plus rapidement. Cette idée, annonçait déjà le futur Organe d’appel (OA) qui sera mis en place avec la création de l’OMC.
Par la suite, les propositions canadiennes ont progressivement gagné du terrain et ont été intégrées aux négociations du cycle d’Uruguay.
B. La contribution du Canada dans la réforme intérimaire du mécanisme de règlement des différends à mi-parcours du cycle d’Uruguay (1986–89)
Malgré les avancées du cycle de Tokyo, les procédures restaient assujetties au consensus et vulnérables aux blocages politiques des grandes puissances. Le Canada, convaincu de l’importance d’un cadre plus contraignant et impartial, a joué un rôle moteur dans les négociations d’Uruguay, cycle lors duquel les Membres s’étaient donnés pour mandat “d’améliorer et de renforcer les règles et procédures de règlement des différends” “en vue d’assurer un règlement prompt et efficace des différends.”Footnote 13 Afin de favoriser une issue positive à ces négociations, le Canada s’est proposé comme hôte de plusieurs rencontres internationales, notamment la réunion ministérielle de Montréal en 1988.Footnote 14 L’ambassadeur John Weekes, représentant permanent du Canada auprès du GATT, soulignait à cette occasion que “l’économie mondiale était en pleine réforme, que les différends commerciaux se multipliaient et que le GATT devait se doter de processus décisionnels plus efficaces.”Footnote 15
En octobre 1988, un groupe de paysFootnote 16 a soumis un texte de travail visant à introduire plusieurs changements fondamentaux pour le mécanisme de règlement des différends du GATT. Footnote 17 La proposition la plus notable portait sur l’établissement des groupes spéciaux en jetant les bases du “consensus inversé.” Contrairement au consensus traditionnel ou “positif,” où une décision ne peut être adoptée que si aucun membre ne s’y oppose, le consensus inversé permet l’adoption automatique d’une décision, sauf si tous les membres présents s’accordent pour la rejeter.Footnote 18 Autrement dit, la proposition du Canada consistait à rendre automatique l’établissement d’un groupe spécial au plus tard lors de la réunion de l’ORD qui suivait celle où une partie intéressée en faisait la demande. De plus, réitérant une proposition qu’ils avaient déjà formulée en 1984,Footnote 19 ils suggéraient la création d’un roster et la possibilité de demander au directeur général de composer le groupe spécial si les parties intéressées ne parvenaient pas à s’entendre sur la sélection des experts dans le cadre d’un différend donné. Enfin, la proposition du Canada qui remontait aux discussions post-Tokyo relative à la qualité et la compétence des membres qui constituent les groupes spéciaux avait également été reprise dans les négociations d’Uruguay.Footnote 20
Une autre initiative importante portée dans ce document de travail concernait l’introduction d’un mécanisme de “surveillance multilatérale” et l’octroi d’un “délai raisonnable de mise en œuvre” pour garantir que les décisions rendues par les groupes spéciaux ne restent pas lettre morte. Ce dispositif de suivi visait à assurer la mise en œuvre effective des recommandationsFootnote 21 et à éviter que certaines parties contractantes ne contournent leurs obligations. Cette initiative s’inspirait directement d’une communication de la délégation canadienne qui datait de novembre 1984.Footnote 22 Cette proposition, bien qu’elle diffère du mécanisme finalement adopté sous l’article 21 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum de 1994), a jeté les bases du suivi multilatéral qui caractérise aujourd’hui le règlement des différends à l’OMC.Footnote 23
Les discussions autour de ces propositions lors de la réunion ministérielle de Montréal en 1988 ont abouti à un projet de décisionFootnote 24 qui a été formellement adoptée en 1989Footnote 25 afin d’entrer en vigueur avant même la fin du cycle d’Uruguay. Le Mémorandum de 1994 a par la suite repris ces évolutions procédurales apportées en 1989. Cette réforme intérimaire avait permis un rapprochement avec les pratiques instaurées par certains accords issus du cycle de Tokyo, en particulier le code antidumping, qui prévoyait déjà un processus de règlement des différends obligatoire. L’automaticité de l’établissement des groupes spéciaux, combinée au renforcement du rôle du directeur général pour résoudre les situations de blocage dans la sélection des panélistes, devait mettre fin à la possibilité pour les parties contractantes de bloquer les procédures de règlement des différends. Toutefois, la règle du consensus demeurait pour l’adoption des rapports des groupes spéciaux, offrant ainsi toujours une dernière possibilité pour les parties contractantes de bloquer l’adoption des rapports qui leur étaient défavorables.Footnote 26
3. La contribution du Canada au renforcement du mécanisme de règlement des différends lors du passage du GATT à l’OMC (1989–95)
Cette partie revient sur les principales propositions du Canada qui ont abouti à la création de l’ORD qui demeure aujourd’hui encore une des pierres angulaires du système commercial multilatéral.Footnote 27 Le Canada, acteur de premier plan dans ces négociations, a activement œuvré pour l’instauration d’un système juridictionnalisé, automatique et contraignant, garantissant à la fois sécurité juridique et prévisibilité dans le règlement des différends commerciaux internationaux.
A. Les propositions du Canada dans une dynamique de judiciarisation du mécanisme de règlement des différends
En matière de règles et procédures de règlement des différends, les négociations d’Uruguay ont été marquées par une tendance à la judiciarisation.Footnote 28 Celle-ci a commencé lors de la révision intérimaire de 1989 avec le mécanisme de surveillance et l’établissement automatique des groupes spéciaux, puis s’est poursuivie jusqu’à la réunion ministérielle de Marrakech en 1994 qui a acté la création de l’OMC et de son ORD.
La contribution la plus novatrice du Canada aux négociations mena à l’élargissement du consensus inversé à la procédure d’adoption des rapports des groupes spéciaux, une évolution qui allait profondément modifier la dynamique du règlement des différends à l’OMC.Footnote 29 Si l’établissement des groupes spéciaux avait déjà été rendu automatique, l’adoption des rapports nécessitait toujours un consensus. Cette proposition de réforme qui a finalement été transposée dans le Mémorandum de 1994 garantit qu’un membre ne puisse avoir la possibilité de bloquer l’adoption des rapports défavorables, renforçant ainsi le caractère obligatoire et contraignant des recommandations.
Un autre jalon essentiel dans la réforme du règlement des différends découla de la proposition canadienne de novembre 1987, visant à créer un conseil dédié exclusivement au règlement des différends avec un président spécifique.Footnote 30 Cette initiative posa ainsi les premiers fondements de l’ORD. En structurant davantage le règlement des différends et en assurant une spécialisation accrue des instances chargées de leur résolution, cette réforme permit de professionnaliser et juridictionnaliser davantage le système, garantissant ainsi un cadre plus prévisible et efficace pour la gestion des litiges commerciaux internationaux.
En suggérant la création d’un organe spécial et en instaurant le consensus inversé, le Canada a contribué à renforcer l’efficacité et l’impartialité du système de règlement des différends, assurant ainsi une plus grande prévisibilité et stabilité du commerce international. Il a également marqué une avancée majeure vers la judiciarisation des procédures, en veillant à ce que les décisions ne puissent plus être entravées par des considérations purement politiques.
B. Les propositions du Canada pour contrer les (possibles) effets négatifs de l’adoption automatique des rapports des groupes spéciaux
La proposition pour l’automaticité dans l’adoption des rapports des groupes spéciaux soulevait une préoccupation majeure: que faire en cas de décisions juridiquement contestables ou insuffisamment motivées? Les négociateurs craignaient que certains rapports de groupes spéciaux, mal fondés ou mal argumentés, ne deviennent obligatoires sans qu’aucun mécanisme ne permette de corriger d’éventuelles erreurs. Conscient de ces risques, le Canada a proposé deux instruments complémentaires pour garantir la qualité et la cohérence des décisions rendues: un mécanisme de révision des rapports avant leur adoption définitive et la création d’un Organe d’appel.Footnote 31 Ces deux mécanismes avaient pour objectif de contrebalancer la force du consensus inversé, en offrant aux parties la possibilité de contester et de corriger d’éventuelles erreurs de droit ou d’interprétation.
Le mécanisme de révision proposé par le Canada visait à ajouter une étape permettant aux groupes spéciaux de clarifier leurs constatations ou de corriger les éventuelles erreurs d’interprétation ou de qualification des faits. Il offre ainsi une première opportunité aux parties au différend de prévenir des erreurs d’interprétation, des constatations erronées ou de clarifier certains points. Pour autant, dans la pratique, cette possibilité est devenue en grande partie une occasion de régler de petites questions factuelles, les pays gardant leurs arguments sur les erreurs juridiques du groupe spécial pour l’examen en appel.
L’autre pilier des propositions canadiennes pour garantir la cohérence et la prévisibilité des décisions fut la création d’un Organe d’appel permanent. L’idée d’établir un groupe d’experts permanent avait émergé dans les discussions dès 1982,Footnote 32 mais ce n’est qu’en 1990 que le Canada a formalisé l’idée d’en faire un organe d’appel. Le mécanisme d’appel a été conçu pour traiter les rares rapports de panel “fondamentalement viciés.” Le Canada a même suggéré que l’OA puisse décider de ne pas entendre un appel si le cas ne le justifiait pas.Footnote 33 Comme l’expliquait Elaine Feldman, l’objectif était de fournir un moyen de corriger les erreurs fondamentales dans l’interprétation des droits et obligations. Rétrospectivement, les parties n’avaient pas prévu que l’Organe d’appel soit en réalité utilisé pour la quasi-totalité des rapports des groupes spéciaux, souvent d’ailleurs pour des raisons de politique intérieure.
Si ces deux propositions ont depuis été consacrées par le Mémorandum de 1994,Footnote 34 elles avaient été reprises, dès décembre 1991 dans le Dunkel Draft. Footnote 35 En soutenant la mise en place d’un mécanisme d’appel et d’un possible réexamen préalable des rapports des groupes spéciaux, le Canada a contribué à renforcer l’un des aspects fondamentaux du règlement des différends de l’OMC: la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions.Footnote 36 Ces réformes ont permis d’assurer une jurisprudence plus cohérente et d’éviter des interprétations contradictoires des règles commerciales multilatérales. Aujourd’hui, malgré la crise de l’OA, l’importance de ces avancées demeure incontestée et témoigne du rôle clé du Canada dans la structuration d’un système commercial mondial fondé sur la règle de droit.
4. L’engagement continu du Canada en faveur de l’Organe de règlement des différends depuis 1995
Depuis l’institutionnalisation de l’OMC en 1995, le Canada a fait preuve d’un engagement constant en faveur du règlement multilatéral des différends. Son implication ne s’est pas limitée aux négociations ayant conduit à la création de l’ORD; elle s’est poursuivie au fil des années, à travers une participation active aux procédures, ainsi que par la contribution d’experts canadiens au sein des groupes spéciaux et de l’OA. Cette partie examine ainsi la contribution continue du Canada à l’ORD, tant par son expertise et sa participation aux différends commerciaux, que par son leadership dans la défense d’un mécanisme obligatoire et contraignant, garant de la prévisibilité et de la sécurité juridique du système commercial multilatéral.
A. L’implication du Canada et de ses experts dans les procédures de règlement des différends à l’OMC
Commençons ici par rendre hommage aux Canadiennes et Canadiens qui, par leurs contributions, ont joué un rôle clé au sein de l’ORD: Parmi ces personnalités figurent Elaine Feldman et Debra Steger, négociatrices canadiennes sur la création du système de règlement des différends.Footnote 37 Feldman était basée à Genève, alors que Steger était basée à Ottawa. Après l’entrée en vigueur de l’OMC et son ORD, Steger a été la première directrice du Secrétariat de l’Organe d’Appel (OA) de 1995 à 2001. Elle a instauré plusieurs pratiques de gestion des différends et règles de travail qui perdurent encore aujourd’hui.Footnote 38 John Weekes a été président du Conseil général de l’OMC en 1998 (et avait été président du Conseil du GATT en 1993). Ambassadeur du Canada auprès de l’OMC de 1995 à 1999, il a également présidé le Groupe spécial chargé de résoudre le différend entre l’Inde et les États-Unis concernant les importations automobiles.Footnote 39 John Gero a été président de l’ORD en 2009 et l’année suivante président du Conseil général. Jonathan Fried a été président de l’ORD en 2013 et en 2014, il fut président du Conseil général. Valerie Hughes a occupé des fonctions clés à l’OMC, d’abord en tant que directrice du Secrétariat de l’OA de 2001 à 2005, puis en tant que directrice de la Division des affaires juridiques de 2010 à 2016. Enfin, une référence peut être faite à tous les experts canadiens de l’ombre qui ont ou qui travaillent pour le Secrétariat de l’OMC.Footnote 40
Outre ces quelques personnalités, le Canada a fourni un important contingent d’experts dont le rôle fut déterminant dans les groupes spéciaux et l’OA. En 2019, Valérie Hughes soulignait que “[m]ore than 250 individuals have served as WTO panellists since 1995. Twenty-two different Canadians have served as WTO panellists so far, which is more in total than from any other WTO member.”Footnote 41 À ce jour, sur 332 panélistes, vingt-trois étaient canadiens.Footnote 42 La renommée canadienne se singularise également par la diversité de ses acteurs en termes de genre et de domaines d’expertises. On y distingue des diplomates de haut niveau, des universitaires spécialisés, des praticiens, ainsi que des anciens ministres du Commerce et négociateurs commerciaux. Le Canada détient, d’ailleurs, le record du nombre de femmes ayant servi comme panélistes, avec cinq Canadiennes ayant contribué à des panels, dont l’une à sept reprises.Footnote 43
Force est également de reconnaître que le Canada a été particulièrement proactif dans les procédures de règlement des différends. Il se classe au troisième rang des 166 membres de l’OMC en termes de nombres de différends portés devant l’ORD comme plaignant, et au sixième rang pour le nombre de différends en tant que défendeur.Footnote 44 À ce jour, le Canada a initié quarante-quatre affaires, dont vingt-trois contre les États-Unis et neuf contre l’Union européenne.Footnote 45 En tant que défendeur, le Canada a été impliqué dans vingt-quatre différends, dont huit ont été initiés par les États-Unis, six par l’Union européenne et quatre par le Brésil.Footnote 46 De plus, nous remarquons que le Canada a joué un rôle important en tant que tierce partie, en participant à un total de 181 différends.Footnote 47 Le nombre significatif de différends auxquels le Canada a participés fait que son importance sur l’interprétation du droit de l’OMC ne peut être ignorée. Toutefois, du fait que les Groupes spéciaux et l’Organe d’appel suivent généralement leur propre raisonnement et que les arguments du Canada pouvaient être repris des parties tierces ou soutenus par elles, il est sans doute difficile de définir la contribution spécifique du Canada sur l’interprétation du droit de l’OMC.
B. Le leadership du Canada face à la crise de l’Organe de règlement des différends
En dépit des nombreuses évolutions qu’a connues le mécanisme de règlement des différends et malgré les résultats incontestables qu’il a livrés, force est de reconnaître que l’ORD n’a sans doute pas encore atteint sa forme finale. Si l’histoire est un éternel recommencement, revoilà le système commercial multilatéral plongé dans la crise de confiance qu’il avait traversé dans les années 1980. Et pour cause, depuis 2019, l’OA de l’OMC ne peut plus traiter de nouvelles affaires, offrant ainsi la possibilité au Membre d’échapper aux rapports qui lui sont défavorables en laissant périr la procédure au stade d’un appel qui ne peut pas être entendu.Footnote 48 Ce blocage de l’OA entraîne un dysfonctionnement de l’ensemble de l’ORD et cette incertitude majeure qui en résulte peut à terme éroder l’effectivité du système commercial multilatéral. Cette paralysie découle principalement du blocage par les États-Unis de la nomination de nouveaux membres de l’OAFootnote 49 sous couvert de plusieurs griefs qui leur sont adressés.Footnote 50
Dans ce contexte de crise, le Canada a joué un rôle déterminant dès 2016 en initiant des discussions visant à renforcer l’efficacité du système de règlement des différends de l’OMC. Dans un document distribué le 11 juillet 2016, le Canada incitait alors les Membres à participer à un “mécanisme pour l’élaboration, la documentation et la communication de pratiques et procédures pour le déroulement des différends.”Footnote 51 Le Canada appelait à l’instauration d’un mécanisme de coopération entre les Membres pour la mise en place de pratiques et procédures de travail novatrices pour les groupes spéciaux auquel il a grandement contribué.Footnote 52 À partir de 2018, le Canada a également été à l’initiative du Groupe d’OttawaFootnote 53 dont le but est de faire face aux défis qui pèsent sur le système commercial multilatéral, contribuant ainsi à une réforme globale de l’OMC qui ne se limite pas seulement au renforcement du mécanisme de règlement des différends.Footnote 54
Le Canada peut aussi revendiquer la paternité de l’Arrangement multipartite pour une procédure arbitrale d’appel provisoire (AMPA).Footnote 55 En effet, l’engagement du Canada s’est intensifié au moment où les Membres de l’OMC ont été confrontés à un OA inopérant. Dès juillet 2019, le Canada et l’Union européenne avaient signé un accord bilatéral permettant de recourir à l’arbitrage en cas de différend à l’OMC, anticipant ainsi l’hypothèse où l’OA viendrait à ne plus pouvoir siéger.Footnote 56 En avril 2020 cette fois, dix-neuf membres, dont le Canada et l’Union européenne (ainsi que ses vingt-sept États membres), ont notifié à l’ORD leur intention de recourir à un “Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d’appel provisoire.”Footnote 57 Avec cette procédure, les membres qui ont signé l’AMPA renoncent à leur droit de faire appel devant l’OA de l’OMC et bénéficient d’une procédure devant un tribunal arbitral, conformément à l’article 25 du Mémorandum de 1994, qui supplée l’OA jusqu’à ce que ce dernier puisse siéger de nouveau. L’AMPA a ainsi été instauré en raison de “circonstances extraordinaires” afin d’éviter le scénario de l’appel dans le “vide” et de préserver un système de règlement des différends à deux niveaux.Footnote 58 Depuis son lancement, huit autres membres ont adhéré à l’AMPA, portant à cinquante-quatre le nombre total de participants.Footnote 59 L’AMPA regroupe dix arbitres et chaque affaire est entendue par trois d’entre eux à la fois. Valerie Hughes du Canada est l’un d’eux. L’AMPA n’est certes pas une solution universelle, mais il a eu des effets positifs, notamment dans le règlement rapide du différend Colombie – Frites surgelées (DS591). Footnote 60 Cette initiative se veut aussi inclusive puisque ses procédures peuvent également être utilisées sur une base ad hoc, par des membres de l’OMC qui ne sont pas parties à l’AMPA. Ce fut notamment le cas de la Turquie dans un différend l’opposant à l’Union européenne.Footnote 61 Il est aussi possible d’évoquer les deux différends où les parties, également membres de l’AMPA, s’étaient abstenues de faire appel du rapport des groupes spéciaux.Footnote 62
Le fonctionnement de l’AMPA est essentiellement basé sur celui de l’OA en termes de procédures mais certaines améliorations ont été mises en place, notamment pour rationaliser les procédures. Afin de respecter les délais qui sont impartis aux arbitres, ils ont la possibilité de prendre des mesures organisationnelles qui peuvent inclure des limites du nombre de pages, de temps et de dates pour la remise des communications écrites et orales.Footnote 63 Les arbitres peuvent aussi suggérer d’exclure les griefs fondés sur l’absence d’évaluation objective des faits qui devait être réalisée par le groupe spécial en ce que de telles allégations amènent bien souvent l’OA à réévaluer inutilement les faits de la cause.Footnote 64 Aussi, nous avons pu constater dans l’affaire Colombie – Frites surgelées (DS591), la mise en place à l’initiative des arbitres d’une audience préparatoire afin de déterminer les questions qui devaient être abordées par les parties lors de l’audience.Footnote 65 Il est intéressant de noter que les aménagements procéduraux qui ont été apportés par l’AMPA sont intégrés dans les négociations actuelles pour la réforme de l’ORD.Footnote 66 Dans ces discussions, même certains éléments de la proposition du Canada de 1990 qui a mené à la création de l’OAFootnote 67 sont repris, comme la possibilité d’intégrer un mécanisme de filtrage des appels.Footnote 68 Encore aujourd’hui, le Canada participe très activement dans les travaux de négociations pour réformer le système de règlement des différends, puisqu’un des six coorganisateurs des négociations, Stacy-Paul Healy, est membre de la délégation canadienne.Footnote 69
5. Conclusion
Si le Canada a été un acteur clé dès les premières heures du GATT, il s’est progressivement imposé comme un contributeur incontournable au renforcement des procédures de règlement des différends du GATT et de l’OMC, en plaidant pour un système obligatoire et quasi judiciaire, fondé sur la règle de droit. L’influence que le Canada a pu avoir sur l’évolution du mécanisme de règlement des différends s’explique aussi par sa place particulière dans l’échiquier politique. Il était à la fois membre du groupe de la PaixFootnote 70 et de la Quad,Footnote 71 Feldman explique ainsi que le Canada pouvait dire à la Quad ce que le groupe de la Paix pensait et pouvait faire part à ce même groupe des points de vue de la Quad étant ainsi au cœur de la recherche du consensus. Toutefois, son engagement n’a pas attendu l’ouverture du cycle d’Uruguay: il a joué un rôle moteur dans la consolidation des règles dès les premières réformes du GATT, avant de s’investir activement dans les négociations qui ont abouti à la création de l’ORD, et enfin, il a poursuivi son engagement en défendant l’ORD face aux défis contemporains. Ainsi, à travers son long engagement, le Canada a joué un rôle essentiel pour renforcer et préserver l’intégrité et l’efficacité du mécanisme de règlement des différends du système commercial multilatéral.
Face aux difficultés rencontrées par le système de règlement des différends de l’OMC, le Canada s’est distingué par une approche pragmatique en proposant la Déclaration sur un mécanisme pour l’élaboration, la documentation et la communication de pratiques et procédures pour le déroulement des différends. Cette initiative, fondée sur le volontariat, permet aux membres qui le souhaitent de s’accorder sur des modalités procédurales adaptées à leurs besoins spécifiques. Sans remettre en cause les règles existantes, elle offre une flexibilité bienvenue, en contribuant à une meilleure efficacité du système et en facilitant le règlement des différends dans un esprit de coopération. En ce sens, elle s’inscrit dans une dynamique constructive visant à répondre aux limites actuelles du système, sans exiger une réforme institutionnelle globale, dont la perspective reste incertaine à ce jour.
Cette démarche illustre également une évolution plus large de l’OMC, qui, faute de parvenir à des résultats pleinement multilatéraux, tend à se transformer progressivement en un forum multilatéral au sein duquel émergent des sous-groupes ouverts, porteurs de solutions concrètes et inclusives lesquelles pourront évoluer vers des accords qui lieront tous les membres OMC et même devenir éventuellement universels. Ce qui demeure extraordinaire, c’est le dévouement, et la fidélité du Canada pour tous les systèmes d’échanges, de collaboration, de développement et de règlement des différends.